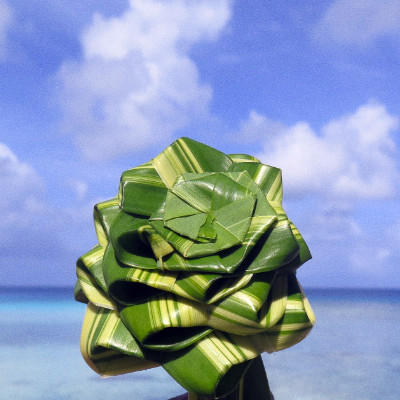rédigé par Gaëlle Poyade pour l'édition 2025
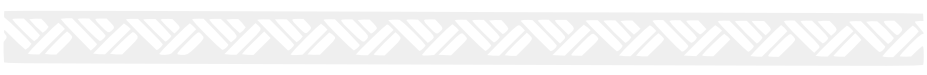
Te reko pakumotu : les langues des Tuāmotu
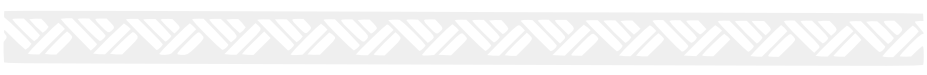
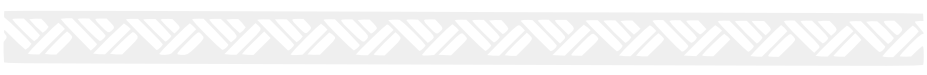

Langue vernaculaire propre à l’archipel des Tuāmotu, le paumotu, dénommé reko pakumotu, est un pilier fondamental de la culture polynésienne. Comme bien des langues minoritaires, parlées de surcroit par une population restreinte – les habitants des Tuāmotu sont évalués à 15 000 –, le reko pakumotu, fragilisé, fait l’objet de programmes, projets et missions éducatives afin de le sauvegarder.
Te reko pakumotu regroupe en réalité 7 grandes aires linguistiques ayant chacune leur langue propre, leurs lexiques spécifiques, et parfois mêmes des constructions grammaticales distinctes. Aujourd’hui, toutes sont influencées par la langue tahitienne. Notons le cas particulier de Rangiroa, qui appartient à l’aire linguistique Mihiroa. Pour des raisons historiques anciennes, les habitants s’y expriment en un tahitien mâtiné de spécificités lexicales locales.


Depuis la fin du XXe siècle, la transmission familiale n’est plus systématique au profit du tahitien et du français qui sont perçus comme des langues symbole de réussite scolaire, sociale ou encore religieuse. En outre, l’éclatement de l’archipel des Tuāmotu en environ 80 atolls ne facilite ni le travail de conservation ni celui de diffusion des différentes langues. Enfin, l’exode vers Tahiti et la prépondérance du français à l’école ont encore davantage réduit leurs usages.
Pour enrayer la tendance, des initiatives ont vu le jour, à savoir la création, en 2008, de l’Académie paumotu Kāruru Vānaga. Outre ses missions linguistiques (normalisation et codification des divers parlers), elle encourage pléthore de publications, recueils de contes, légendes, proverbes, ouvrages de référence tels que Tuāmotu te kaiga, langues et cultures, Na ku teie hakari ainsi que la nouvelle collection Na ku teie – Cahiers des Trésors des Tuāmotu. Par ailleurs, le Kāruru Vānaga a lancé un chantier de traduction des Évangiles tout en s’affairant à la création de dictionnaires bilingues paumotu-français/paumotu-tahitien sans oublier divers outils pédagogiques destinés aux enseignants.

À l’école primaire, les langues polynésiennes sont inscrites au programme à raison de 2h30 par semaine, aussi les langues paumotu sont-elles a priori enseignées, comme le parata à ’Ana’a ou le maragai à Nukutāvake. L’école primaire de Hao se distingue avec la mise en place d’une parité horaire français/paumotu. Et, chaque année, le concours d’art oratoire organisé par la Direction de l’Éducation (DGEE) permet aux petits élèves paumotu de se réapproprier leurs langues et leurs traditions culturelles par la déclamation de textes anciens. Le paumotu est enseigné jusqu’à l’université de Polynésie française via la Licence LLCER (1) où il compte parmi les matières obligatoires en 1ère année.
Rien de plus efficace que la chanson pour pérenniser une langue et contribuer à son rayonnement. Stars locales, les Barthélémy, Emma Mariteragi, Antoine Arakino et, encore plus d’actualité, Teiho Tetoofa, participent à sa diffusion, ce jusqu’en dehors des frontières territoriales. Plusieurs fêtes et festivals, portés par les danses, les chants ou bien les récits traditionnels mettent également les langues paumotu à l’honneur, à l’instar des Makeva organisés par les associations Te Reo o te Tuāmotu et Pu Tahi Haga no Ganaa depuis l’année 2000, ainsi que du festival Makeva, dont la prochaine édition se tiendra du 3 au 8 novembre 2025 à Rangiroa.

Concurrentes à certaines heures, les langues paumotu et tahitienne n’en sont pas moins intimement liées. Le « k », cette consonne qui appartient à l’alphabet paumotu, fait l’objet d’études au sein de l’Académie tahitienne Te Fare Vāna’a pour l’intégrer à l’alphabet tahitien. La traduction de la Bible en tahitien a, en effet, imposé l’usage de la lettre et du phonème « k » pour certains termes religieux (issus de l’hébreu, du grec, de l’anglais). Ainsi, en tahitien, on prie Kiritō, à savoir le christ.
Le débat en cours a le mérite de rendre plus visible la langue paumotu pour laquelle une reconnaissance politique renforcerait sa légitimité et contribuerait à préserver l’identité linguistique et culturelle des Tuāmotu. La stèle symbolique représentant les sept reko pakumotu, installée à Tautira au sud de Tahiti, en juillet 2025, est là pour le rappeler.
(1) Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales